- STRUCTURE DANS LES SCIENCES HUMAINES
- STRUCTURE DANS LES SCIENCES HUMAINESLes sciences humaines utilisent de plus en plus couramment la notion de structure. Cependant, la signification de celle-ci est loin d’être claire et donne souvent lieu à de faux problèmes. Par ailleurs, le mouvement structuraliste est, semble-t-il, limité à certaines disciplines telles que l’anthropologie et la linguistique. L’importance prise par la notion de structure est un symptôme intéressant des changements qui ont affecté les sciences sociales et humaines dans un passé récent. Cette notion est unie à la notion de système, elle-même corrélative de celle de modèle. Dans un premier temps, l’idée de système renvoie aux applications téléologiques. Avec Galilée, système et téléologie sont relégués au profit d’un modèle mécaniste qui restera dominant jusqu’à l’avènement de la cybernétique, laquelle, avec l’apparition ultérieure de la théorie des systèmes, a donné une nouvelle vie à ce dernier concept qui est central pour les sciences humaines comme le montrent les notions de Gestalt (forme) en psychologie, de système politique en science politique ou de système social en sociologie. Par le développement de la méthode des modèles mathématiques, il devient possible de traiter des systèmes dans un langage scientifique. C’est pourquoi l’expansion de l’idée de structure est aussi corrélative de la mathématisation des sciences humaines, car l’analyse structurale n’est finalement pas autre chose qu’une analyse de systèmes, c’està-dire une théorie permettant de rendre compte de l’interdépendance des éléments d’un objet conçu comme une totalité.Dans certaines disciplines, l’approche systémique a remplacé assez brutalement une approche descriptive (linguistique, anthropologie). Dans d’autres (économie, sociologie), l’approche est systémique dès l’origine. C’est pourquoi il n’y a pas de mouvement de rupture structuraliste dans ces domaines. Si l’expansion de la notion de structure dans les sciences humaines est interprétée comme indiquant leur tendance à proposer une analyse scientifique d’objets conçus comme systèmes, la plupart des faux problèmes philosophiques soulevés par le structuralisme s’évanouissent.La notion de structure est complexe. En anthropologie et en linguistique, elle est associée à une révolution scientifique: alors que, dans la tradition classique, ces disciplines étaient principalement descriptives, l’anthropologie et la linguistique structurales sont abstraites et formalisées. En sociologie, une des théories dominantes est le structuro-fonctionnalisme. Si l’on ne parle guère d’une économie structurale, on évoque les méthodes structurales de l’économie. En psychologie, l’importance de la structure est attestée, entre autres, par les travaux de J. Piaget.D’un autre point de vue, les sciences humaines se différencient par rapport à cette notion: on distingue une linguistique et une anthropologie structurales, mais non une économie ou une sociologie structurales; un anthropologue s’avouera structuraliste, non un sociologue. Cette différence est une première difficulté épistémologique soulevée par le concept de structure. L’autre, plus tangible encore, réside dans la prolifération des textes théoriques qui s’efforcent de définir et de préciser ce concept, montrant ainsi son caractère polysémique. En bref, la structure apparaît à la fois indispensable à toutes les sciences humaines, comme en témoigne la fréquence croissante de son emploi, et difficilement cernable. Enfin, il faut noter que la vogue du concept de structure et du structuralisme est récente. Cela invite à s’interroger sur sa signification par rapport au développement récent des sciences humaines.La mathématisation des sciences humainesLe terme de structure a un sens bien défini en mathématiques: ainsi, considérant certains éléments et un ensemble d’opérations définies sur ces éléments et munies de propriétés données, on construit des structures particulières (structures d’espace vectoriel, de groupe, d’anneau, par exemple), ou bien considérant les éléments d’un ensemble, si ces éléments peuvent tous être rangés les uns par rapport aux autres, eu égard à une relation transitive, on parlera d’une structure d’ordre total. Ainsi, l’ensemble des nombres entiers a une structure d’ordre total par rapport à la relation «plus grand que». En effet, si a et b sont deux nombres entiers différents, on aura toujours soit a 礪 b , soit b 礪 a , et on vérifie que la relation « 礪» est transitive (c’est-à-dire si a 礪 b , et b 礪 c , alors a 礪 c ).Parfois, la notion de structure a, dans les sciences humaines, une signification proche de la signification mathématique. Ainsi, on dira que les réponses à un questionnaire sont munies d’une structure hiérarchique si elles constituent un ordre total: supposons qu’on ait interrogé n sujets et qu’on leur ait posé cinq questions a , b , c , d , e , leur demandant de répondre à chaque question par oui ou par non. Admettons qu’ayant dépouillé les réponses on ait observé qu’une réponse positive à a est toujours accompagnée d’une réponse positive à b , cette dernière entraînant une réponse positive à c , laquelle est toujours accompagnée d’une réponse positive à d , et une réponse positive à d toujours accompagnée d’une réponse positive à e . Cette structure peut être résumée de la manière suivante:
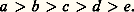 Une réponse positive à a entraîne une réponse positive à b , laquelle entraîne une réponse positive à c , etc. Dans ce cas, on a mis en évidence la présence d’une structure mathématique connue (ordre total) au sein d’un ensemble de réponses à partir du moment où l’on a défini la relation a 礪 b par : «Tous ceux qui répondent positivement à a répondent positivement à b .» Une grande partie de la théorie du questionnaire, en psychologie sociale et en psychologie, consiste précisément à associer des structures mathématiques à des ensembles de réponses en définissant de manière appropriée des relations entre ces réponses. Ce premier exemple montre que l’apparition et le développement de la notion de structure dans les sciences humaines sont liés à la mathématisation à la fois explosive et récente de ces sciences. Dans de nombreux cas, on parle de structure pour indiquer qu’avec des définitions appropriées un ensemble de données peut être interprété comme ayant une structure mathématique particulière.Un autre exemple fait saisir que toutes les sciences humaines font un ample usage de la notion de corrélation entre variables. Ainsi, il y a généralement une corrélation positive, qu’on peut mesurer, entre le nombre des ouvriers et le nombre des voix communistes dans un ensemble de circonscriptions; il y a aussi une corrélation positive entre le nombre d’ouvriers et le loyer moyen, et ainsi de suite. Si l’on suppose que chaque quartier peut être ainsi caractérisé par rapport à m variables, il est alors possible, en les groupant par paires, de calculer m (m – 1)/2 corrélations entre ces m variables (car chacune est à relier à toutes moins elle-même et, pour ne pas doubler le prisme des possibles, il faut diviser le total par 2); il est aussi possible de représenter ces corrélations par un ensemble de distances dans un espace comprenant au maximum m (m – 1)/2 – 1 dimensions: les données seront alors représentées sous la forme d’une structure d’espace vectoriel (cf. STATISTIQUES, chap. III).Rapport avec la notion de systèmeIl est certain que l’extension de la notion de structure dans les sciences humaines est liée à leur mathématisation croissante. Mais, dans de nombreux cas, la notion de structure est indépendante de tout formalisme mathématique au moins explicite, comme dans le structuro-fonctionnalisme sociologique de Talcott Parsons (cf. FONCTION ET FONCTIONNALISME, en particulier chap. II et III), dans la critique littéraire structuraliste, ou même dans la phonologie structurale de R. Jakobson [cf. PHONOLOGIE]. Dans tous les cas, cette notion apparaît en corrélation avec celle de système. Le schéma épistémologique peut être résumé de la façon suivante: un chercheur, qu’il soit linguiste, économiste, sociologue, politologue, se propose d’analyser un objet conçu comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble d’éléments interdépendants, ne prenant sens que les uns par rapport aux autres, en un mot constituant une totalité; il imagine alors, selon le cas, soit un ensemble de concepts, soit une théorie, soit un modèle permettant de rendre compte de cette interdépendance. La théorie, le système conceptuel ou le modèle sont alors interprétés comme la structure de l’objet considéré.Quelques exemplesAnalysant quelques systèmes de parenté caractéristiques de sociétés archaïques, C. Lévi-Strauss observe des éléments difficilement explicables. Ainsi, de nombreuses sociétés autorisent le mariage entre cousins croisés (mariage d’Ego avec la fille du frère de sa mère ou avec la fille de la sœur de son père), mais proscrivent le mariage entre cousins parallèles (mariage avec la fille de la sœur de la mère ou avec la fille du frère du père). Plus curieusement encore, certaines sociétés proscrivent un des types de mariage entre cousins croisés et non l’autre. Ces observations excluent toute explication de type eugénique puisque la proximité sanguine est la même dans tous les cas. L’apport de Lévi-Strauss a été de montrer que les différents systèmes de règles d’autorisation et d’interdiction du mariage sont des solutions particulières apportées au problème qui se pose aux sociétés archaïques d’organiser la circulation des femmes entre les segments composant la société. Le fait que la société Tarau autorise le mariage avec la fille du frère de la mère, mais proscrive le mariage avec la fille de la sœur du père, alors que la société Kariera autorise les deux types de mariage, devient alors intelligible.On peut prendre un autre exemple: Parsons s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’institution familiale a tendance, dans les sociétés industrielles, à se réduire à la famille nucléaire (composée des parents et des enfants, par opposition à la famille étendue, incluant ascendants et collatéraux). La réponse structuro-fonctionnaliste de Parsons consiste à concevoir les institutions, au sens large du mot, économiques et familiales comme composant un système d’éléments interdépendants. Dans une société de type industriel, l’adaptation des individus au marché de l’emploi suppose, d’une part, que les liens familiaux avec leurs ascendants soient suffisamment lâches pour ne pas gêner la mobilité géographique; et, d’autre part, que l’enfant puisse s’orienter vers une profession différente de celle de son père, de sorte qu’on peut parler d’une homologie de structure entre la famille de type nucléaire et l’organisation industrielle des sociétés. Réciproquement, il y a homologie de structure entre la famille de type étendu et l’organisation économique des sociétés traditionnelles.En linguistique, l’analyse structurale consiste, de même, à concevoir les éléments d’une langue, qu’il s’agisse de phonèmes ou d’entités appartenant à des niveaux plus complexes (syntaxe, par exemple), comme des ensembles d’éléments interdépendants, c’est-à-dire des systèmes.Outre la mathématisation, une seconde cause du développement de la notion de structure est donc attribuable à l’insistance croissante des sciences humaines sur la notion de système. Cette tendance peut être observée dans toutes les disciplines : à la psychologie atomistique de type béhavioriste se substitue la Gestalttheorie , première forme d’une psychologie structurale (cf. GESTALTISME), la linguistique historisante dérivée de la tradition philologique est remplacée avec F. de Saussure, N. S. Troubetzkoy et de nombreux auteurs par l’analyse des systèmes linguistiques [cf. LINGUISTIQUE]; à l’ethnographie descriptive, qui considère les éléments des sociétés comme juxtaposés et vise des explications de type généalogique, se substitue l’anthropologie structurale qui repose sur le postulat de l’interdépendance entre ces éléments [cf. ANTHROPOLOGIE].Système et finalitéOn peut se demander pourquoi la progression de la notion de système dans les sciences humaines est récente, au moins pour certaines d’entre elles. Cette notion, à défaut du mot, est, en effet, fort ancienne et remonte à la philosophie grecque. Ainsi Aristote conçoit-il explicitement comme des systèmes non seulement les êtres vivants mais les sociétés.Ce qui devait d’abord desservir la notion de système dans sa première version et aboutir à sa rélégation, c’est sa dimension téléologique. Les équivalents aristotéliciens de son acception moderne sont indissolublement associés au concept de cause finale. Avec Galilée, ce dernier disparaît, et le modèle mécaniste devient le modèle par excellence de la pensée scientifique. Il fallut attendre le développement de la cybernétique pour que la notion de système soit réintégrée dans la pensée scientifique: avec la cybernétique, la liaison entre le concept de système et la notion de cause finale est dissoute. Les systèmes ne sont plus conçus comme supposant un type d’explication particulier; les phénomènes de rééquilibration d’un système perturbé par des influences extérieures sont expliqués non plus téléologiquement mais à l’aide de schémas mécanistes dont le niveau de complexité est seulement supérieur aux schémas galiléens (introduction de la rétroaction, ou feed back ).En fait, la notion de système a pratiquement toujours été présente dans les sciences humaines. Ce qui caractérise leur développement récent, c’est donc plutôt qu’elles soient parvenues, dans certains cas au moins, à donner à cette notion une valeur opératoire et scientifique, suivant une évolution scientifique générale dont la cybernétique représente le témoignage le mieux connu.Ce développement des sciences humaines a été rendu en général possible par le recours aux modèles mathématiques: de même que la notion de structure est liée à celle de système, de même l’analyse des systèmes, par laquelle sont mises en évidence les structures, est liée au développement du langage mathématique et de la méthode des modèles.Structures et modèlesL’économie est probablement la première discipline qui soit parvenue à une expression mathématique des systèmes. Les travaux de L. Walras et de V. Pareto traitent de systèmes de variables interdépendantes, analysant notamment les conditions de leur équilibre.En linguistique et en anthropologie, le processus a été différent. Les deux disciplines ont connu une longue tradition descriptive avant de s’orienter vers l’analyse de leurs objets en termes de systèmes. Dans les deux cas, la mutation structuraliste a été accompagnée d’un recours à la formalisation mathématique et, en fait, rendue possible par elle. Chez les pionniers de la phonologie structurale, comme Troubetzkoy, Jakobson ou Z. Harris, cette formalisation reste très élémentaire et relève de simples modèles de classification. Elle est plus complexe chez certains auteurs plus récents, N. Chomsky par exemple, avec qui la linguistique structurale devient, en réalité, un corpus de modèles mathématiques. En anthropologie, le tournant structuraliste, qu’on peut associer, entre autres, aux noms de G. P. Murdock ou de Lévi-Strauss, est également corrélatif d’une introduction de la méthode des modèles. Chez Murdock, il s’agit de modèles statistiques simples, chez Lévi-Strauss de modèles algébriques plus complexes.La situation de la sociologie se rapproche, par certains côtés, de celle de l’économie: la notion de système y est d’un usage à peu près aussi ancien (bien que le mot ne soit pas toujours explicitement employé) que la discipline elle-même. Ainsi, le projet même de L’Esprit des lois de Montesquieu consiste à analyser les systèmes formés par les lois, mœurs, institutions, coutumes, etc. des nations, à distinguer les types de systèmes possibles, à déterminer les principes de chaque système. Il suffit de relire les premières pages du livre classique de Montesquieu pour voir que la traduction moderne la plus convenable du concept d’esprit des lois est probablement celle de structure sociale , au sens où Murdock emploie cette expression. Bref, le structuralisme sociologique est contemporain de la sociologie elle-même. On le retrouve aussi bien chez Montesquieu ou chez Tocqueville que chez le sociologue américain Parsons. Cela explique, sans doute, qu’on ne parle pas de sociologie structurale: c’est pour la même raison que l’expression «économie structurale» est peu employée.Il y a toutefois une différence importante entre sociologie et économie, à savoir que l’association entre l’approche systémique et la mathématisation n’apparaît pas de façon aussi évidente dans la première discipline que dans la seconde.Il n’y a guère de progrès, du point de vue de la formalisation, entre la sociologie de Tocqueville et celle de Parsons. Dans les deux cas, les outils formels utilisés appartiennent au genre le plus élémentaire: celui de la classification et de la pseudo-corrélation. Cependant, ce piétinement n’est pas propre à l’ensemble de la sociologie. Dans certaines branches de cette discipline (théorie de la mobilité sociale, théorie des organisations, théorie des conflits, théorie du pouvoir, par exemple), on assiste au contraire à un développement considérable des modèles mathématiques. La situation de la sociologie supposerait une analyse particulière qui ne peut être entreprise ici. La principale raison de la relative stagnation de cette discipline est probablement due à l’attachement des sociologues à la définition héritée de Comte qui fait de la sociologie une «science générale des sociétés». Dès que ce point de vue est abandonné et que le sociologue cesse de s’interroger sur la société dans son ensemble pour se donner des objets abstraits (circulation des individus dans les structures sociales, pouvoir, par exemple), on assiste à des progrès considérables de la formalisation mathématique et de l’analyse scientifique des systèmes.Un diagnostic se dégage de cette brève évocation historique: si on se réfère à un point idéal, qui est loin d’être atteint, mais vers lequel les sciences humaines dans leur ensemble se dirigent de manière incontestable, on constate que le développement de la notion de structure dans les sciences humaines est corrélatif: d’une part, de la réintroduction, notamment par la cybernétique et la théorie des systèmes, de la notion de système dans le langage scientifique; d’autre part, de la convergence entre ce développement et le fait que, traditionnellement, de nombreuses sciences humaines conçoivent leurs objets comme systèmes (c’est le cas, en psychologie, de la notion de gestalt; en sociologie, de celle de système social; en science politique, de celle de système politique, par exemple); enfin, du développement des modèles mathématiques dans les sciences humaines, qui permettent de donner une formalisation précise de la notion d’interdépendance entre les éléments d’un système et d’analyser les conséquences de cette interdépendance.Représentation de la réalitéCe développement des sciences humaines soulève un problème de nature philosophique qui peut être formulé de la manière suivante: faut-il interpréter les structures mises en évidence dans les sciences humaines en termes réalistes, comme équivalentes aux essences de la philosophie scolastique ou, au contraire, comme de simples représentations mentales, à la fois commodes et arbitraires? Ce problème, qui a été maintes fois posé au niveau des commentaires philosophiques qui ont accompagné certains progrès récents des sciences humaines (le développement de l’anthropologie structurale, par exemple), n’a de réalité que dans la mesure où la notion de structure reste confuse et mal définie.L’analyse précédente suggère que l’analyse structurale d’un objet est toujours, implicitement ou explicitement, maladroitement ou de façon convaincante, une théorie permettant de rendre compte de l’interdépendance des éléments de cet objet conçu comme système. Par exemple, si l’on suppose que l’ensemble x décrive les règles matrimoniales d’une société et que T soit un modèle dont une des solutions est x, on dira que T est une interprétation de la structure de x dans la mesure où il rend compte de l’interdépendance des éléments de x.L’interprétation de T pose alors les mêmes problèmes philosophiques que n’importe quelle théorie scientifique: on ne peut jamais assurer qu’elle exprime la structure de la réalité; car il est toujours possible de trouver une théorie plus générale ou de mettre à jour des faits qui ne peuvent pas être expliqués par cette théorie. Une interprétation réaliste de la théorie est donc impossible. Mais une interprétation nominaliste est également impossible dans la mesure où une théorie scientifique est celle qui s’expose à l’épreuve de la réalité et qui, par conséquent, ne peut être tenue pour une représentation arbitraire de cette réalité.Un autre malentendu persistant voit dans le structuralisme et dans le recours à la notion de structure dans les sciences humaines un danger de statisme: la notion de structure n’est-elle pas antithétique de celle du changement? Le problème dérive, ici encore, d’une interprétation naïve (ou cultivant intentionnellement la confusion) de la notion de structure. En effet, si l’analyse structurale n’est ni plus ni moins qu’une analyse des systèmes, la difficulté s’évanouit, une théorie pouvant évidemment être, selon les cas, comme le démontre, par exemple, l’économie, statique ou dynamique.Un point mérite finalement d’être souligné: le développement de l’analyse structurale dans les sciences de l’homme aura progressivement pour effet d’abaisser les frontières disciplinaires, dans la mesure où des systèmes, qui peuvent paraître distincts tant qu’on se situe à un niveau descriptif, peuvent être indistincts d’un point de vue formel. Les emprunts de l’anthropologie structurale à la linguistique sont significatifs à cet égard: lorsqu’on disposera d’une théorie formalisée du pouvoir, il est possible, comme le suggère Parsons, que cette théorie puisse être formellement comparable à certains mécanismes économiques.L’apparition et l’expansion de la notion de structure dans les sciences humaines sont donc à la fois le symptôme et le signe annonciateur d’un changement profond dans le langage de ces sciences. Le fait que cette notion soit souvent mal comprise et environnée de connotations métaphysiques est, pour sa part, corrélatif de l’inégal développement des sciences humaines et de leurs difficultés à employer un langage scientifiquement satisfaisant.
Une réponse positive à a entraîne une réponse positive à b , laquelle entraîne une réponse positive à c , etc. Dans ce cas, on a mis en évidence la présence d’une structure mathématique connue (ordre total) au sein d’un ensemble de réponses à partir du moment où l’on a défini la relation a 礪 b par : «Tous ceux qui répondent positivement à a répondent positivement à b .» Une grande partie de la théorie du questionnaire, en psychologie sociale et en psychologie, consiste précisément à associer des structures mathématiques à des ensembles de réponses en définissant de manière appropriée des relations entre ces réponses. Ce premier exemple montre que l’apparition et le développement de la notion de structure dans les sciences humaines sont liés à la mathématisation à la fois explosive et récente de ces sciences. Dans de nombreux cas, on parle de structure pour indiquer qu’avec des définitions appropriées un ensemble de données peut être interprété comme ayant une structure mathématique particulière.Un autre exemple fait saisir que toutes les sciences humaines font un ample usage de la notion de corrélation entre variables. Ainsi, il y a généralement une corrélation positive, qu’on peut mesurer, entre le nombre des ouvriers et le nombre des voix communistes dans un ensemble de circonscriptions; il y a aussi une corrélation positive entre le nombre d’ouvriers et le loyer moyen, et ainsi de suite. Si l’on suppose que chaque quartier peut être ainsi caractérisé par rapport à m variables, il est alors possible, en les groupant par paires, de calculer m (m – 1)/2 corrélations entre ces m variables (car chacune est à relier à toutes moins elle-même et, pour ne pas doubler le prisme des possibles, il faut diviser le total par 2); il est aussi possible de représenter ces corrélations par un ensemble de distances dans un espace comprenant au maximum m (m – 1)/2 – 1 dimensions: les données seront alors représentées sous la forme d’une structure d’espace vectoriel (cf. STATISTIQUES, chap. III).Rapport avec la notion de systèmeIl est certain que l’extension de la notion de structure dans les sciences humaines est liée à leur mathématisation croissante. Mais, dans de nombreux cas, la notion de structure est indépendante de tout formalisme mathématique au moins explicite, comme dans le structuro-fonctionnalisme sociologique de Talcott Parsons (cf. FONCTION ET FONCTIONNALISME, en particulier chap. II et III), dans la critique littéraire structuraliste, ou même dans la phonologie structurale de R. Jakobson [cf. PHONOLOGIE]. Dans tous les cas, cette notion apparaît en corrélation avec celle de système. Le schéma épistémologique peut être résumé de la façon suivante: un chercheur, qu’il soit linguiste, économiste, sociologue, politologue, se propose d’analyser un objet conçu comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble d’éléments interdépendants, ne prenant sens que les uns par rapport aux autres, en un mot constituant une totalité; il imagine alors, selon le cas, soit un ensemble de concepts, soit une théorie, soit un modèle permettant de rendre compte de cette interdépendance. La théorie, le système conceptuel ou le modèle sont alors interprétés comme la structure de l’objet considéré.Quelques exemplesAnalysant quelques systèmes de parenté caractéristiques de sociétés archaïques, C. Lévi-Strauss observe des éléments difficilement explicables. Ainsi, de nombreuses sociétés autorisent le mariage entre cousins croisés (mariage d’Ego avec la fille du frère de sa mère ou avec la fille de la sœur de son père), mais proscrivent le mariage entre cousins parallèles (mariage avec la fille de la sœur de la mère ou avec la fille du frère du père). Plus curieusement encore, certaines sociétés proscrivent un des types de mariage entre cousins croisés et non l’autre. Ces observations excluent toute explication de type eugénique puisque la proximité sanguine est la même dans tous les cas. L’apport de Lévi-Strauss a été de montrer que les différents systèmes de règles d’autorisation et d’interdiction du mariage sont des solutions particulières apportées au problème qui se pose aux sociétés archaïques d’organiser la circulation des femmes entre les segments composant la société. Le fait que la société Tarau autorise le mariage avec la fille du frère de la mère, mais proscrive le mariage avec la fille de la sœur du père, alors que la société Kariera autorise les deux types de mariage, devient alors intelligible.On peut prendre un autre exemple: Parsons s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’institution familiale a tendance, dans les sociétés industrielles, à se réduire à la famille nucléaire (composée des parents et des enfants, par opposition à la famille étendue, incluant ascendants et collatéraux). La réponse structuro-fonctionnaliste de Parsons consiste à concevoir les institutions, au sens large du mot, économiques et familiales comme composant un système d’éléments interdépendants. Dans une société de type industriel, l’adaptation des individus au marché de l’emploi suppose, d’une part, que les liens familiaux avec leurs ascendants soient suffisamment lâches pour ne pas gêner la mobilité géographique; et, d’autre part, que l’enfant puisse s’orienter vers une profession différente de celle de son père, de sorte qu’on peut parler d’une homologie de structure entre la famille de type nucléaire et l’organisation industrielle des sociétés. Réciproquement, il y a homologie de structure entre la famille de type étendu et l’organisation économique des sociétés traditionnelles.En linguistique, l’analyse structurale consiste, de même, à concevoir les éléments d’une langue, qu’il s’agisse de phonèmes ou d’entités appartenant à des niveaux plus complexes (syntaxe, par exemple), comme des ensembles d’éléments interdépendants, c’est-à-dire des systèmes.Outre la mathématisation, une seconde cause du développement de la notion de structure est donc attribuable à l’insistance croissante des sciences humaines sur la notion de système. Cette tendance peut être observée dans toutes les disciplines : à la psychologie atomistique de type béhavioriste se substitue la Gestalttheorie , première forme d’une psychologie structurale (cf. GESTALTISME), la linguistique historisante dérivée de la tradition philologique est remplacée avec F. de Saussure, N. S. Troubetzkoy et de nombreux auteurs par l’analyse des systèmes linguistiques [cf. LINGUISTIQUE]; à l’ethnographie descriptive, qui considère les éléments des sociétés comme juxtaposés et vise des explications de type généalogique, se substitue l’anthropologie structurale qui repose sur le postulat de l’interdépendance entre ces éléments [cf. ANTHROPOLOGIE].Système et finalitéOn peut se demander pourquoi la progression de la notion de système dans les sciences humaines est récente, au moins pour certaines d’entre elles. Cette notion, à défaut du mot, est, en effet, fort ancienne et remonte à la philosophie grecque. Ainsi Aristote conçoit-il explicitement comme des systèmes non seulement les êtres vivants mais les sociétés.Ce qui devait d’abord desservir la notion de système dans sa première version et aboutir à sa rélégation, c’est sa dimension téléologique. Les équivalents aristotéliciens de son acception moderne sont indissolublement associés au concept de cause finale. Avec Galilée, ce dernier disparaît, et le modèle mécaniste devient le modèle par excellence de la pensée scientifique. Il fallut attendre le développement de la cybernétique pour que la notion de système soit réintégrée dans la pensée scientifique: avec la cybernétique, la liaison entre le concept de système et la notion de cause finale est dissoute. Les systèmes ne sont plus conçus comme supposant un type d’explication particulier; les phénomènes de rééquilibration d’un système perturbé par des influences extérieures sont expliqués non plus téléologiquement mais à l’aide de schémas mécanistes dont le niveau de complexité est seulement supérieur aux schémas galiléens (introduction de la rétroaction, ou feed back ).En fait, la notion de système a pratiquement toujours été présente dans les sciences humaines. Ce qui caractérise leur développement récent, c’est donc plutôt qu’elles soient parvenues, dans certains cas au moins, à donner à cette notion une valeur opératoire et scientifique, suivant une évolution scientifique générale dont la cybernétique représente le témoignage le mieux connu.Ce développement des sciences humaines a été rendu en général possible par le recours aux modèles mathématiques: de même que la notion de structure est liée à celle de système, de même l’analyse des systèmes, par laquelle sont mises en évidence les structures, est liée au développement du langage mathématique et de la méthode des modèles.Structures et modèlesL’économie est probablement la première discipline qui soit parvenue à une expression mathématique des systèmes. Les travaux de L. Walras et de V. Pareto traitent de systèmes de variables interdépendantes, analysant notamment les conditions de leur équilibre.En linguistique et en anthropologie, le processus a été différent. Les deux disciplines ont connu une longue tradition descriptive avant de s’orienter vers l’analyse de leurs objets en termes de systèmes. Dans les deux cas, la mutation structuraliste a été accompagnée d’un recours à la formalisation mathématique et, en fait, rendue possible par elle. Chez les pionniers de la phonologie structurale, comme Troubetzkoy, Jakobson ou Z. Harris, cette formalisation reste très élémentaire et relève de simples modèles de classification. Elle est plus complexe chez certains auteurs plus récents, N. Chomsky par exemple, avec qui la linguistique structurale devient, en réalité, un corpus de modèles mathématiques. En anthropologie, le tournant structuraliste, qu’on peut associer, entre autres, aux noms de G. P. Murdock ou de Lévi-Strauss, est également corrélatif d’une introduction de la méthode des modèles. Chez Murdock, il s’agit de modèles statistiques simples, chez Lévi-Strauss de modèles algébriques plus complexes.La situation de la sociologie se rapproche, par certains côtés, de celle de l’économie: la notion de système y est d’un usage à peu près aussi ancien (bien que le mot ne soit pas toujours explicitement employé) que la discipline elle-même. Ainsi, le projet même de L’Esprit des lois de Montesquieu consiste à analyser les systèmes formés par les lois, mœurs, institutions, coutumes, etc. des nations, à distinguer les types de systèmes possibles, à déterminer les principes de chaque système. Il suffit de relire les premières pages du livre classique de Montesquieu pour voir que la traduction moderne la plus convenable du concept d’esprit des lois est probablement celle de structure sociale , au sens où Murdock emploie cette expression. Bref, le structuralisme sociologique est contemporain de la sociologie elle-même. On le retrouve aussi bien chez Montesquieu ou chez Tocqueville que chez le sociologue américain Parsons. Cela explique, sans doute, qu’on ne parle pas de sociologie structurale: c’est pour la même raison que l’expression «économie structurale» est peu employée.Il y a toutefois une différence importante entre sociologie et économie, à savoir que l’association entre l’approche systémique et la mathématisation n’apparaît pas de façon aussi évidente dans la première discipline que dans la seconde.Il n’y a guère de progrès, du point de vue de la formalisation, entre la sociologie de Tocqueville et celle de Parsons. Dans les deux cas, les outils formels utilisés appartiennent au genre le plus élémentaire: celui de la classification et de la pseudo-corrélation. Cependant, ce piétinement n’est pas propre à l’ensemble de la sociologie. Dans certaines branches de cette discipline (théorie de la mobilité sociale, théorie des organisations, théorie des conflits, théorie du pouvoir, par exemple), on assiste au contraire à un développement considérable des modèles mathématiques. La situation de la sociologie supposerait une analyse particulière qui ne peut être entreprise ici. La principale raison de la relative stagnation de cette discipline est probablement due à l’attachement des sociologues à la définition héritée de Comte qui fait de la sociologie une «science générale des sociétés». Dès que ce point de vue est abandonné et que le sociologue cesse de s’interroger sur la société dans son ensemble pour se donner des objets abstraits (circulation des individus dans les structures sociales, pouvoir, par exemple), on assiste à des progrès considérables de la formalisation mathématique et de l’analyse scientifique des systèmes.Un diagnostic se dégage de cette brève évocation historique: si on se réfère à un point idéal, qui est loin d’être atteint, mais vers lequel les sciences humaines dans leur ensemble se dirigent de manière incontestable, on constate que le développement de la notion de structure dans les sciences humaines est corrélatif: d’une part, de la réintroduction, notamment par la cybernétique et la théorie des systèmes, de la notion de système dans le langage scientifique; d’autre part, de la convergence entre ce développement et le fait que, traditionnellement, de nombreuses sciences humaines conçoivent leurs objets comme systèmes (c’est le cas, en psychologie, de la notion de gestalt; en sociologie, de celle de système social; en science politique, de celle de système politique, par exemple); enfin, du développement des modèles mathématiques dans les sciences humaines, qui permettent de donner une formalisation précise de la notion d’interdépendance entre les éléments d’un système et d’analyser les conséquences de cette interdépendance.Représentation de la réalitéCe développement des sciences humaines soulève un problème de nature philosophique qui peut être formulé de la manière suivante: faut-il interpréter les structures mises en évidence dans les sciences humaines en termes réalistes, comme équivalentes aux essences de la philosophie scolastique ou, au contraire, comme de simples représentations mentales, à la fois commodes et arbitraires? Ce problème, qui a été maintes fois posé au niveau des commentaires philosophiques qui ont accompagné certains progrès récents des sciences humaines (le développement de l’anthropologie structurale, par exemple), n’a de réalité que dans la mesure où la notion de structure reste confuse et mal définie.L’analyse précédente suggère que l’analyse structurale d’un objet est toujours, implicitement ou explicitement, maladroitement ou de façon convaincante, une théorie permettant de rendre compte de l’interdépendance des éléments de cet objet conçu comme système. Par exemple, si l’on suppose que l’ensemble x décrive les règles matrimoniales d’une société et que T soit un modèle dont une des solutions est x, on dira que T est une interprétation de la structure de x dans la mesure où il rend compte de l’interdépendance des éléments de x.L’interprétation de T pose alors les mêmes problèmes philosophiques que n’importe quelle théorie scientifique: on ne peut jamais assurer qu’elle exprime la structure de la réalité; car il est toujours possible de trouver une théorie plus générale ou de mettre à jour des faits qui ne peuvent pas être expliqués par cette théorie. Une interprétation réaliste de la théorie est donc impossible. Mais une interprétation nominaliste est également impossible dans la mesure où une théorie scientifique est celle qui s’expose à l’épreuve de la réalité et qui, par conséquent, ne peut être tenue pour une représentation arbitraire de cette réalité.Un autre malentendu persistant voit dans le structuralisme et dans le recours à la notion de structure dans les sciences humaines un danger de statisme: la notion de structure n’est-elle pas antithétique de celle du changement? Le problème dérive, ici encore, d’une interprétation naïve (ou cultivant intentionnellement la confusion) de la notion de structure. En effet, si l’analyse structurale n’est ni plus ni moins qu’une analyse des systèmes, la difficulté s’évanouit, une théorie pouvant évidemment être, selon les cas, comme le démontre, par exemple, l’économie, statique ou dynamique.Un point mérite finalement d’être souligné: le développement de l’analyse structurale dans les sciences de l’homme aura progressivement pour effet d’abaisser les frontières disciplinaires, dans la mesure où des systèmes, qui peuvent paraître distincts tant qu’on se situe à un niveau descriptif, peuvent être indistincts d’un point de vue formel. Les emprunts de l’anthropologie structurale à la linguistique sont significatifs à cet égard: lorsqu’on disposera d’une théorie formalisée du pouvoir, il est possible, comme le suggère Parsons, que cette théorie puisse être formellement comparable à certains mécanismes économiques.L’apparition et l’expansion de la notion de structure dans les sciences humaines sont donc à la fois le symptôme et le signe annonciateur d’un changement profond dans le langage de ces sciences. Le fait que cette notion soit souvent mal comprise et environnée de connotations métaphysiques est, pour sa part, corrélatif de l’inégal développement des sciences humaines et de leurs difficultés à employer un langage scientifiquement satisfaisant.
Encyclopédie Universelle. 2012.
